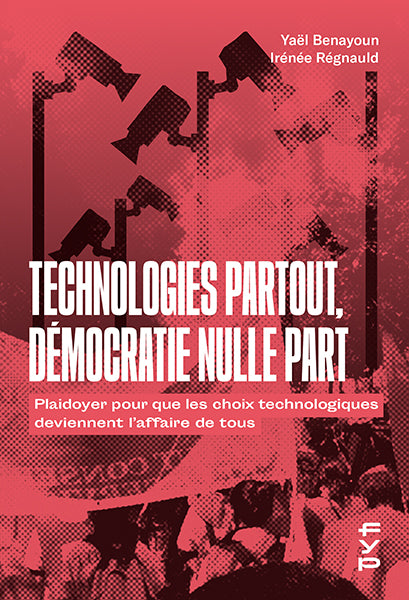Le texte qui suit est une traduction d’un article publié pour la première fois dans le magazine Ms., volume I, numéro 2, septembre/octobre 1990, sous le titre « Israel: Whose country is it anyway? ». La photo de couverture, c’est une marche de l’organisation pacifiste et féministe Women Wage Peace, qui rassemble des femmes israéliennes et palestiniennes.
C’est le mien. Le débat est clos. Israël m’appartient. Du moins s’agit-il de ce qu’on m’a inculqué. J’y plante des arbres depuis toujours. Je me souviens du sein de ma mère — de la faim (elle était malade et faible) ; de l’ablation de mes amygdales quand j’avais deux ans et demi — de la peur et du papier peint de l’hôpital ; des cauchemars de l’enfance ; de l’abandon prématuré ; de la plantation d’arbres en Israël. Comprenez : avant même de savoir reconnaître un arbre dans la vie réelle, je plantais déjà des arbres en Israël. À Camden, où j’ai grandi, il y avait du ciment. Je pensais que l’immense et majestueux poteau téléphonique qui se trouvait en face de notre maison en briques en était un — un arbre ; seulement, il n’avait pas de feuilles. Je n’étais pas à plaindre : les fils étaient impressionnants. Aujourd’hui encore, lorsque je pense à « un arbre », je revois ce morceau de bois mort craquelé et brunâtre, ses fils noirs étendus vers le ciel. Je dois faire un effort pour me souvenir qu’un arbre est plus frêle et plus vert, en tout cas dans sa version archétypale, et dans les zones tempérées. Il me faut un acte adulte de volonté pour me rappeler qu’un arbre pousse vers le ciel et s’enracine dans le sol, à la différence d’un poteau téléphonique, même majestueux.
En Israël, comme à Camden, il n’y avait pas d’arbres. Chez nous, c’était le ciment ; en Israël, c’était le désert. Ils avaient besoin d’arbres. Nous non. Nous vivions aux États-Unis, où il y avait abondance de tout, même d’arbres, alors qu’en Israël, il n’y avait rien. Nous devions donc leur fournir des arbres. À la synagogue, on nous a donné des dossiers : du papier blanc, lourd, épais ; de l’encre bleue, légère, qui évoquait le vert. Le blanc et le bleu, c’étaient les couleurs d’Israël. À l’intérieur de la chemise, il y avait un arbre imprimé en bleu clair. L’arbre était plein, rond, presque gonflé, luxuriant. Chaque branche en engendrait de nombreuses autres, toutes chargées de bouquets de feuilles. Dans chaque bouquet, nous devions mettre une pièce de dix cents. Nous pouvions utiliser notre argent de poche, mais cela ne suffisait pas ; nous devions donc demander à des parents, des étrangers, au policier sur la route de l’école, au concierge de l’école — à tous ceux qui étaient en mesure de nous donner une pièce de dix cents, parce que nous devions remplir notre dossier, puis en commencer un autre et ainsi de suite. Chaque pièce de dix cents était insérée dans une petite fente dans le bouquet de feuilles, de sorte que chaque branche finissait par être chargée de pièces de dix cents. À la fin, c’était comme si des pièces poussaient sur l’arbre imprimé. Cela signifiait que vous aviez collecté assez d’argent pour planter un arbre en Israël — votre propre arbre, avec votre nom dessus. Sur le dossier, vous inscriviez aussi un autre nom, afin de dédier l’arbre à une personne disparue. Les familles juives ne manquaient jamais de morts, mais dans les années qui suivirent ma naissance, après 1946, les morts avaient submergé les vivants. Les morts étaient partout. Quel que soit son âge, on en connaissait. Des charniers, des os, des cendres, des fours, des numéros sur les avant-bras. Être juive et vivante était — presque — inhabituel. Dès l’enfance, on ressentait un sentiment de solitude. On éprouvait presque une sorte de malaise à être vivant. En avez-vous assez d’en entendre parler ? Soyez indulgents. C’était nouveau pour moi, à l’époque. J’étais une enfant. Les adultes voulaient nous empêcher de sombrer dans la morbidité, l’anxiété ou la peur. Ils ne voulaient pas que nous soyons différentes des autres enfants. Ils nous l’ont dit et ne nous l’ont pas dit. Ils nous l’ont dit, puis se sont ravisés. Ils chuchotaient, puis niaient avoir chuchoté. Tout va bien. Vous êtes en sécurité ici, aux États-Unis. Être juif, c’est comme être américain : c’est ce qu’on fait de mieux. C’était un vaste secret qu’ils essayaient de garder et de raconter en même temps. Ils étaient adultes — ils n’y croyaient toujours pas vraiment. Contrairement aux enfants.
À l’école hébraïque, j’avais deux types de professeurs. D’une part des hommes juifs aux yeux brillants du New Jersey, issus des banlieues surtout, et de Philadelphie, un haut lieu de culture — des hommes médiocres, de piètres enseignants, leurs aspirations étant plus bourgeoises que talmudiques. Et d’autre part des survivants des anciens ghettos européens, passés par Auschwitz et Bergen-Belsen — polyglottes, érudits, spectraux, aux yeux opalescents. Aucun, bien sûr, ne savait parler hébreu. C’était une langue morte, comme le latin. Le nouveau projet israélien visant à relancer l’hébreu était considéré comme une expérience vouée à l’échec. L’anglais serait la langue d’Israël. Ce n’était qu’une question de temps. L’État d’Israël est grand comme celui du New Jersey. Israël est un miracle, une grande aventure, mais aussi un endroit étrangement familier.
La difficulté, concernant la dédicace de l’arbre, c’était d’avoir un vrai nom à écrire sur votre dossier et de savoir qui était cette personne pour vous. Il était important pour les Juifs américains de paraître normaux. Or, les autres connaissent le nom de leurs morts. Nous avions trop de morts pour connaître leur nom ; le meurtre de masse est un effacement. Celles et ceux qui avaient immigré aux États-Unis avaient laissé derrière des sœurs, des frères, des mères, des tantes, des oncles, des cousins — qui avaient été massacrés. Où ? Quand ? Allez savoir. Les parents de mon père étaient des immigrants russes. Ceux de ma mère étaient hongrois. Mes grands-parents ont toujours refusé de parler de l’Europe. « Des ordures », me dit le père de mon père, « ce sont tous des ordures ». Il parlait des Européens. Il s’était enfui de Russie à l’âge de 15 ans, pour échapper au tsar. Il avait des frères et des sœurs, sept ; je n’ai jamais rien pu apprendre d’autre. Ils étaient morts, à cause des pogroms, de la révolution russe, des nazis ; ils avaient disparu. Mes grands-parents, de chaque côté, se sont enfuis pour leurs propres raisons et sont venus ici. Ils n’ont pas regardé en arrière. Et puis il y eut ce nouveau génocide, nouveau même pour les Juifs. Ils furent incapables de regarder en arrière. Il était impossible de retrouver qui — ou ce qui — avait été perdu. Il ne pouvait y avoir de réconciliation avec ce qui ne pouvait être affronté. Ils étaient vivants parce qu’ils étaient ici ; les autres étaient morts parce qu’ils étaient là-bas : qui pouvait affronter ça ? Très jeune, j’ai remarqué que les enfants chrétiens avaient une parentèle qui m’était inconnue, très âgée, avec des titres honorifiques que je ne connaissais pas — grand-tante, arrière-arrière-grand-mère. Notre famille avait commencé avec mes grands-parents. Personne ne les avait précédés, personne ne s’était tenu à leur côté. Il s’agit d’une amnésie incompréhensible et inquiétante. Il y avait eu Ève ; puis un vide déchirant, un tunnel temporel rempli d’effroyables meurtres ; puis nous. Nous, c’est-à-dire toutes celles et ceux qui étaient dans la pièce. Tous les autres étaient morts. Mon deuil — tous mes arbres plantés dans le désert —, c’était pour eux. Mais qui étaient-ils ? À mes yeux, mes ancêtres ne sont pas des individus. Leur identité, leur être, gît au fond d’un charnier. Dans le petit monde que j’habitais enfant, la conscience était divisée en trois régions : (1) en Europe, avec celles et ceux qui sont restés derrière, les morts ; (2) aux États-Unis, le meilleur des mondes possibles — où l’on s’efforçait d’être plus américain que les Américains ; et (3) en Israël, dans le désert, avec les Juifs qui étaient sortis des cendres pour aller planter des arbres. Je n’ai jamais planté d’arbre à Camden, ni ailleurs d’ailleurs. Tous mes arbres sont en Israël. On m’a dit qu’ils portaient mon nom et qu’ils étaient dédiés à la mémoire de mes morts.
Un jour, à l’école hébraïque, je me suis disputé devant toute la classe avec le directeur, un enseignant, un érudit, qui parlait sept langues, un survivant des camps (je ne sais pas desquels). En privé, il me parlait, répondait à mes questions, contrairement aux autres. Je le voyais trembler, seul ; je lui demandais pourquoi ; il disait que parfois, il ne pouvait pas parler, qu’il n’y avait pas de mots, qu’il ne pouvait rien prononcer, même s’il parlait sept langues ; il disait qu’il avait vu des choses ; qu’il ne pouvait pas dormir ; qu’il n’avait pas dormi depuis des nuits ou des semaines. Je savais qu’il savait des choses importantes. Je le respectais. Chose rare. En général, je ne respectais pas mes professeurs. Devant toute la classe, il nous a dit que dans la vie, nous avions l’obligation d’être d’abord un Juif, ensuite un Américain, enfin un être humain, un citoyen du monde. J’avais été scandalisée. Je lui avais répondu que c’était le contraire. Que nous étions d’abord des êtres humains, des citoyens du monde. Autrement, il n’y aurait jamais la paix, jamais de fin aux conflits nationalistes et aux persécutions raciales. Je devais avoir 11 ans. Il m’a répondu que les Juifs avaient été tués tout au long de l’histoire précisément parce qu’ils pensaient comme moi, parce qu’ils plaçaient le fait d’être Juif en dernier, parce qu’ils ne comprenaient pas que l’on était toujours d’abord un Juif — dans l’histoire, aux yeux du monde, aux yeux de Dieu. Je lui ai rétorqué que c’était le contraire. Que c’est seulement lorsque nous serons d’abord des humains que les Juifs seront en sécurité. Il m’a répondu que les juifs comme moi avaient eu le sang d’autres Juifs sur les mains tout au long de l’histoire ; que s’il y avait eu un Israël, les Juifs n’auraient pas été massacrés dans toute l’Europe ; que la patrie juive était le seul espoir de liberté pour les Juifs. Je lui ai répondu que c’était exactement pourquoi on avait l’obligation d’être un Américain en second lieu, et un être humain d’abord : parce qu’il n’y a que dans une démocratie exempte de religion d’État que les minorités religieuses peuvent avoir des droits, être en sécurité ou ne pas être persécutées ou discriminées. Que s’il y avait un État juif, tous les non-Juifs seraient par définition des citoyens de seconde zone. Que nous n’avions pas le droit de faire aux autres ce qu’on nous avait fait. Plus que quiconque, nous connaissions l’amertume de la persécution religieuse, l’opprobre qui accompagne le fait d’être une minorité. Nous devions être capables d’anticiper les conséquences inévitables d’un État qui nous place en premier, avant les autres. Un État théocratique ne pourrait jamais être un État juste — et les Juifs n’avaient-ils pas besoin d’un État juste ? Si les Juifs avaient eu un État équitable, n’auraient-ils pas été à l’abri des massacres ? Israël pouvait être un début : un État équitable. Mais il ne pouvait pas être un État juif. Le sang des Juifs, m’a‑t-il répondu, serait sur mes mains. Et il est parti. Je ne pense pas qu’il m’ait jamais reparlé.
Vous vous demanderez peut-être si cette histoire est apocryphe, comment je m’en souviens ou comment quelqu’un d’aussi jeune a pu avancer de tels arguments. La réponse est simple : la beauté d’une éducation juive, c’est que, pour peu que l’on soit attentive, l’on apprend à argumenter. Je m’en souviens parce que j’ai été bouleversée par ce qu’il m’a dit : le sang des Juifs sera sur tes mains. Je m’en souviens parce qu’il pensait ce qu’il disait. Une partie de mon éducation a été assurée par des enseignants qui avaient vu trop de morts pour argumenter pour le plaisir d’argumenter. J’aurais du sang sur mes mains, si j’avais tort ; les Juifs n’auraient nulle part ; les Juifs mourraient. Si moi ou quiconque rendait plus difficile l’existence d’Israël, les Juifs risquaient de mourir. Je savais que le projet Israël devait réussir. Tous les Juifs adultes que je connaissais le désiraient, en avaient besoin : les désemparés avec des numéros sur les bras, les immigrants qui étaient venus ici et avaient fui là-bas, les joyeux américanophiles qui voulaient des ranchs pour eux-mêmes, et une armée pour Israël. Israël était la réponse à la quasi-extinction, dans un monde qui s’était montré manifestement indifférent au meurtre de masse des Juifs. C’était aussi le seul moyen pour les Juifs encore en vie de survivre au fait d’avoir survécu. Ceux qui avaient été ici, et non là, par immigration ou par naissance, allaient créer un autre ici, un ici différent, un sanctuaire désiré, et non un sanctuaire trouvé par hasard. Ceux qui étaient vivants devaient trouver un moyen de faire face à la culpabilité monumentale de ne pas être morts : être l’élu, cette fois-ci pour de vrai. La construction d’Israël, c’était un pont au-dessus d’un tas d’ossements, un engagement à vivre contre l’attraction suicidaire du passé. Comment puis-je vivre en ayant vécu cela ? Je bâtirai un endroit où les Juifs pourront vivre.
Je savais, grâce à mes efforts désespérés visant à comprendre le racisme — celui des nazis, mais aussi la haine des Noirs aux États-Unis, l’existence d’une ségrégation légale dans le Sud — qu’Israël était impossible : fondamentalement injuste, conçu pour trahir les aspirations égalitaires, parce que fondé sur une définition raciale du citoyen idéal, sur l’exclusion de celles et ceux qui n’étaient pas juifs. L’égalité sociale était impossible, à moins que seuls des Juifs y vivent. Avec des voisins hostiles et un paradigme racial en guise d’identité étatique, Israël serait soit une forteresse, soit un tombeau. Je ne pensais pas que cela rendait les Juifs plus en sécurité. Je réalisais que cela rendait les Juifs différents : différents des créatures pathétiques dans les trains, des squelettes dans les camps ; différents ; indéniablement différents. C’était un grand soulagement — pour moi aussi — de ne pas être comme les Juifs dans les wagons à bestiaux. Cette différence avait de l’importance. Tant que cela durerait, je l’accepterais. Et si Israël finissait par être un tombeau, un tombeau valait toujours mieux que des fosses communes non marquées pour des millions de personnes dans toute l’Europe. Je me suis accommodée de la différence, ce qui signifie que je me suis accommodée de l’État d’Israël. Je n’aurais pas le sang des Juifs sur les mains. Je ne voulais pas aider ceux qui souhaitaient qu’Israël soit un endroit où davantage de Juifs mourraient, en disant ce que je pensais de son racisme implicite. C’était honteux, vraiment : éloigne-moi, Seigneur, de ces Juifs pitoyables ; fais de moi un être nouveau. Mais c’était réel et à 10, 11, 12 ans, j’en avais besoin.
Vous remarquerez peut-être que tout cela n’a rien à voir avec les Palestiniens. Je ne savais pas qu’il y en avait. D’ailleurs, je n’ai pas non plus parlé des femmes. Je savais qu’elles existaient, formellement parlant. Mme Untel était partout, bien sûr — particulière, renfermée, pleine de retenue et consciencieuse en public. Je n’en ai jamais vu une que j’aurais voulu devenir. Pourtant, les adultes ne cessaient de me menacer en me disant qu’un jour je devrais en être une. Apparemment, c’était le destin, et aussi un travail acharné ; on naissait ainsi, mais il fallait aussi le devenir. Soit on maîtrisait des règles exceptionnellement complexes et obscures, trop nombreuses et onéreuses pour être révélées à un enfant, même à un enfant qui étudie le Lévitique, soit on commettait une erreur, dont la nature n’était jamais précisée. Mais politiquement parlant, les femmes n’existaient pas. Et franchement, en tant qu’êtres humains, les femmes n’existaient pas non plus. On pouvait vivre toute sa vie parmi elles sans jamais savoir qui elles étaient.
On m’a bien parlé des fedayins : des Arabes qui franchissaient la frontière israélienne pour tuer des Juifs. Dans les années après Hitler, c’était monstrueux. Seule une personne dépourvue de toute humanité, de toute conscience, de tout sens de la décence ou de la justice pouvait tuer des Juifs. Ils ne vivaient pas là, ils venaient d’ailleurs. Ils tuaient des civils dans des attaques sournoises ; ils ne se souciaient pas de savoir qui ils tuaient, mais ils tuaient des Juifs.
C’est seulement une fois adulte que je me suis rendue compte que j’avais été élevée avec des préjugés contre les Arabes et que ces préjugés n’étaient pas insignifiants. Mes parents étaient particulièrement attentifs au racisme et au sectarisme religieux — dans leurs versions locales —, à la haine des Noir·es ou des catholiques, par exemple. Leur pédagogie était très courageuse. Ils avaient pris parti contre le racisme et pour les droits civiques, ce qui les avait opposés à de nombreux voisins et membres de notre famille. Ma mère m’avait fait monter dans une voiture et m’avait montré la pauvreté des Noir·es. Peu importe à quel point j’avais l’impression que nous étions pauvres, je devais me rappeler qu’être noir·e aux États-Unis rendait plus pauvre encore. Je me souviens encore d’une conversation avec mon père au cours de laquelle il m’a dit qu’il avait des sentiments racistes à l’égard des Noir·es. Je lui avais répondu que c’était impossible puisqu’il était pour les droits civiques. Il m’avait expliqué le type de sentiments qu’il éprouvait et pourquoi ils étaient mauvais. Il m’avait également expliqué qu’en tant qu’enseignant, puis conseiller d’orientation, il travaillait avec des enfants noir·es et qu’il devait veiller à ce que ses sentiments racistes ne leur nuisent pas. Mon père m’a appris que le fait d’avoir ces sentiments ne les justifiait pas ; que de « bonnes » personnes avaient de mauvais sentiments et que cela ne rendait pas ces sentiments moins mauvais ; que faire face au racisme était un processus, une chose avec laquelle une personne se débattait activement. On m’a également appris que ce n’est pas parce qu’on ressent une chose qu’elle est vraie. Mes parents s’efforçaient de dire « certains Arabes », afin de souligner qu’il y avait de bonnes et de mauvaises personnes dans chaque groupe. Mais mon éducation au sein de la communauté juive m’a fait perdre de vue cette nuance. Les Arabes étaient primitifs, incivilisés, violents. (Mes parents n’auraient jamais accepté de telles généralisations vis-à-vis des Noir·es.) Les Arabes haïssaient et tuaient les Juifs. Au final, on m’a enseigné que les Arabes étaient irrémédiablement mauvais. Au cours de mes nombreux voyages, je n’avais jamais rencontré d’Arabes — l’ignorance est la meilleure amie des préjugés.
Au milieu de la trentaine, j’ai commencé à lire des livres écrits par des Palestiniens. Ces livres m’ont fait réaliser que j’étais mal informée. […] Il y a peut-être 20 ans, j’ai appris qu’ils existaient. J’ai su qu’ils étaient lésés. J’étais en faveur d’une solution à deux États. Au fil des ans, j’ai appris que des Israéliens torturaient des prisonniers palestiniens. J’ai connu des journalistes juifs qui censuraient délibérément des informations afin de ne pas « causer du tort » à l’État juif. Je savais que les droits humains des Palestinien·nes étaient bafoués au quotidien. Comme mon papa, sur les questions sociales, les questions politiques, j’avais les opinions en vogue dans mon milieu. Ces opinions me valaient un conflit permanent avec la communauté juive, y compris avec ma famille, de nombreux ami·es et de nombreuses féministes juives. Pour autant que je sache, la communauté juive n’a que très récemment — mardi dernier, quelque chose comme ça — affronté les faits — les faits actuels. Je ne discuterai pas de la tortueuse histoire, de qui a fait quoi à qui et quand. Je ne discuterai pas du sionisme, sauf pour dire qu’il est évident que je ne suis pas sioniste et que je ne l’ai jamais été. Ce débat rejoint celui que j’eus avec le directeur de mon école hébraïque ; ma position est la même — soit nous créons un monde juste, soit nous continuons à nous faire tuer. (J’ai également remarqué, entre-temps, que les Cambodgiens avaient eu le Cambodge et que cela ne les avait pas beaucoup aidés. Le sadisme social revêt de nombreuses formes. L’inimaginable se produit). Mais il y a les questions de politique sociale, et il y a le racisme qui réside dans le cœur et l’esprit des individus sous forme d’un préjugé concernant tout un peuple. On croit aux stéréotypes, on croit au pire, on accepte une caricature selon laquelle les membres de tel groupe sont risibles ou menaçants, toujours méprisables. Je ne crois pas que les Juifs américains élevés comme je l’ai été soient exempts de ce préjugé. On nous l’a enseigné dès notre plus tendre enfance. Il a permis au gouvernement israélien de justifier auprès de nous ce qu’il avait fait aux Palestinien·nes. Nous avons été aveuglé·es, non seulement par notre besoin d’Israël ou notre loyauté envers les Juifs, mais aussi par un préjugé profond et réel à l’égard des Palestinien·nes qui s’apparente à de la haine raciale.
Le territoire n’était pas inhabité, contrairement à ce qu’on m’avait appris. Ah, certes, il y avait quelques tribus nomades, mais elles n’avaient pas de maisons au sens normal du terme — pas comme nous en avons dans le New Jersey. Il s’agit seulement de quelques individus inéduqués, primitifs et sales, qui ne veulent même pas d’un État. Il y avait des gens et même des arbres — des arbres qui ont été détruits par les soldats israéliens. Les Palestiniens ont raison de dire que les Juifs les considéraient comme des moins que rien. On m’a effectivement appris qu’ils n’étaient rien au sens le plus littéral du terme. S’emparer du pays et le transformer en Israël, l’État juif, était un acte impérialiste. Pour les Juifs, une telle affirmation est incompréhensible. Comment un peuple presque mort, presque éteint, un peuple qui n’était plus que cendres, aurait-il pu impérialiser qui ou quoi que ce soit ? Eh bien, Israël est un phénomène peu commun : des Juifs, presque anéantis, ont accaparé la terre et contraint un monde très hostile à légitimer leur vol. Je pense que les Juifs américains sont incapables d’admettre qu’il s’agit d’un acte — du seul acte — d’impérialisme, de conquête, qu’ils soutiennent. Nous avons aidé, nous en sommes fiers, nous sommes là. Cela contredit toutes les idées que nous professons sur notre identité et sur ce que signifie être juif. Mais c’est un fait. Nous avons pris un pays aux gens qui y vivaient ; nous, les dépossédés, nous en avons dépossédé d’autres ; nous avons dit : « Ce sont des Arabes, qu’ils aillent dans un endroit arabe. » Lorsque les Israéliens disent qu’ils veulent être jugés selon les mêmes normes que le reste du monde, et non selon des normes spécialement conçues pour les Juifs, ils veulent en partie dire que c’est ainsi que va le monde. Il s’agit peut-être d’une première pour les Juifs, mais tout le monde a agi de la sorte au cours de l’histoire. Il s’agit du cours de l’histoire. J’ai grandi dans l’État du New Jersey, qui a la même taille qu’Israël ; il n’y a pas si longtemps, il appartenait aux Indien∙nes. C’est parce que les Juifs américains refusent d’affronter ce fait — que nous avons volé la terre — que les Juifs américains ne peuvent pas se permettre de regarder les Palestinien·nes en face.
Quant aux Palestinien·nes, je ne peux qu’imaginer l’humiliation qu’implique le fait de perdre et d’être conquis par le peuple le plus faible, le plus méprisé et le plus castré de la planète. C’était une remarque féministe sur la masculinité.
Dans mon enfance, la seule fois où j’ai entendu parler de l’égalité des sexes, c’est lorsqu’on m’a appris à aimer le nouvel État d’Israël et à lui être fidèle. Ce nouvel État était apparemment construit sur le principe selon lequel hommes et femmes sont égaux dans tous les domaines. Selon mes professeurs, la servilité n’était pas de mise pour le nouveau Juif — ou la nouvelle Juive. Dans le nouvel État, il n’y avait ni fort ni faible. Le sexe ne déterminait pas la valeur. Tout le travail était partagé : le travail physique, le travail subalterne, la cuisine — il n’y avait pas, pour reprendre la terminologie contemporaine, de stéréotypes ou de rôles sociosexuels. Et comme tout le monde travaillait, tout le monde était également responsable, et tout le monde avait voix au chapitre. Plus particulièrement, les femmes étaient des citoyennes, pas des mères.
Étrangement, il s’agissait de l’aspect le plus original d’Israël. Dans le New Jersey, nous n’avions pas l’égalité des sexes. Dans le New Jersey, personne n’y pensait, personne n’en avait besoin, personne n’en voulait. Nous n’avions pas l’égalité des sexes à l’école hébraïque. Peu importait votre intelligence ou votre dévotion : si vous étiez une fille, vous n’aviez pas le droit de faire quoi que ce soit d’important. Vous n’aviez pas le droit de vouloir autre chose que le mariage, même si vous étiez exceptionnellement érudite. L’égalité des sexes, c’était une chose qu’ils allaient obtenir dans le désert avec les arbres ; nous ne pouvions pas la leur envoyer, car nous ne l’avions pas. C’était un nouveau principe pour un nouveau pays. Et cela a permis de créer un nouveau peuple ; dans le New Jersey, nous n’avions pas ce besoin d’innover.
Quand j’étais enfant, Israël était aussi fondamentalement socialiste. Les kibboutzim, collectifs volontaires, étaient des communautés égalitaires par conception. Les kibboutzim allaient remplacer la famille nucléaire traditionnelle en tant qu’unité sociale de base dans la nouvelle société. Les enfants seraient élevés par l’ensemble de la communauté — ils n’« appartiendraient » pas à leurs parents. La vision communautaire était la pierre angulaire du nouveau pays.
Ici, les femmes étaient presque invisibles. La communauté juive était plutôt animée par l’avidité matérielle, la soif de marchandises et la quête de statut de la classe moyenne. Israël répudiait les valeurs des Juifs américains — mais d’une manière ou d’une autre, les adultes parvenaient à vénérer Israël tout en bafouant au quotidien toutes les valeurs radicales que le nouvel État embrassait. Cependant, cela a possiblement eu une influence importante sur les enfants. Ce n’est sans doute pas pour rien que les enfants juifs de mon âge aspiraient à faire de la vie en communauté une réalité ; ou que les filles ont décidé, en grand nombre, de faire de l’égalité des sexes le socle de nos combats politiques.
Tandis qu’aux États-Unis, les femmes vivaient dans un monde clair-obscur, en tant qu’appendices des hommes, femmes au foyer, les femmes les plus fortes que j’ai connues dans mon enfance œuvraient à l’élaboration, au bien-être et à la préservation de l’État d’Israël. Il s’agissait possiblement du seul domaine d’engagement socialement approuvé. Ma tante Helen, par exemple, la seule femme célibataire et active que j’ai connue dans mon enfance, avait fait d’Israël la cause de sa vie. Non seulement les femmes fortes travaillaient pour Israël, mais même les femmes qui ne l’étaient pas — celles qui étaient conformistes — faisaient montre d’une force rare lorsqu’elles s’engageaient en faveur d’Israël. En tant qu’adultes, l’égalité des sexes les touchaient peut-être d’une manière particulière. Par la suite, le long mandat de Première ministre de Golda Meir nous donna l’impression que la promesse d’égalité était tenue. Elle était nouvelle ; certes, forgée à l’ancienne, visiblement, mais elle s’est elle-même rendue nouvelle par un acte de volonté ; publique ; dirigeante d’un pays en crise. Ma tante Helen et Golda Meir se ressemblaient beaucoup : elles ne se définissaient pas par rapport à des hommes, elles étaient directes alors que d’autres femmes étaient timides, elles étaient coriaces, pleines de ressources, formidables. Les seules femmes formidables que j’ai connues étaient associées à Israël et engagées en sa faveur — à l’exception d’Anna Magnani. Mais c’est une autre histoire.
Enfin, en 1988, à 42 ans, à l’occasion de Thanksgiving, jour où nous célébrons le fait d’avoir réussi à voler cette terre aux Indiens, je me suis rendue en Israël pour la première fois.
Je suis allée à une conférence, la première conférence internationale sur le féminisme juif. Elle avait pour thème l’autonomisation des femmes juives. Et pour sponsors le Congrès juif américain, le Congrès juif mondial et le Réseau des femmes israéliennes (Israel Women’s Network). Son programme reflétait les aspirations de la classe moyenne. Il avait été conçu par des femmes de la classe moyenne, principalement américaines, et inféodées aux dirigeants masculins des groupes qui les sponsorisaient. Les féministes israéliennes laïques qui s’organisaient de manière autonome n’étaient pas dupes. Au départ, elles avaient eu l’intention de boycotter la conférence féministe de l’establishment et d’organiser une conférence féministe alternative, en parallèle. Finalement, elles ont décidé d’organiser leur propre conférence, en incluant des femmes palestiniennes, le lendemain de la fin de la conférence de l’establishment.
J’y suis allée pour les féministes israéliennes. J’y suis allée pour les rencontrer à Haïfa, Tel Aviv et Jérusalem ; pour parler avec celles qui s’organisent contre toutes les violences infligées aux femmes ; pour en apprendre davantage sur la situation des femmes en Israël. J’avais prévu de rester — si je l’avais fait, je me serais aussi exprimée au centre d’aide aux victimes de viol à Jérusalem. À Haïfa, où Phyllis Chesler et moi-même avons pris la parole devant une salle comble (qui comprenait des femmes palestiniennes et quelques jeunes hommes arabes) pour évoquer les problèmes de la garde des enfants et de la pornographie aux États-Unis, les femmes étaient en colère contre la conférence de l’establishment — son programme féministe timoré, son exclusion des pauvres et des féministes palestiniennes. Au bout d’un moment, une femme âgée d’une soixantaine d’années, avec un accent est-européen, peut-être polonais, s’est levée et a dit à peu près ce qui suit : « Bon, il s’agit juste d’une autre conférence organisée par les Américains, comme toutes les autres. Ils en organisent régulièrement. Ils utilisent des innocentes comme elles — elle nous a désignées Phyllis et moi — qui n’y comprennent rien. » Tout le monde a bien ri, surtout nous. Cela faisait longtemps qu’on ne m’avait pas traitée d’innocente, ou qu’on ne m’avait pas perçue comme telle. Mais elle avait raison. Israël m’avait mise à genoux. Innocente, c’était juste. Voici ce qui compromit mon innocence, telle qu’elle était.
1. La Loi du retour
Des femmes juives venues de nombreux pays, dont l’Argentine, la Nouvelle-Zélande, l’Inde, le Brésil, la Belgique, l’Afrique du Sud et les États-Unis, ont assisté à la conférence de l’establishment. Chacune de ces femmes avait apparemment davantage de droit d’être là que n’importe quelle Palestinienne née là-bas, ou dont la mère est née là-bas, ou dont la mère de la mère est née là-bas. Moralement, c’était insupportable. Je m’en rendais viscéralement compte : je n’avais aucunement droit à ce droit.
La Loi du retour stipule que tout Juif arrivant dans le pays peut immédiatement en devenir citoyen ; aucun Juif ne peut être refoulé. Cette Loi est au fondement de l’État juif. Il s’agit de son principe identitaire fondateur et de sa finalité. Les partis religieux orthodoxes, qui ont obtenu une part importante des voix aux dernières élections, souhaitaient que la définition du terme « juif » soit restreinte afin d’exclure les convertis au judaïsme ne l’ayant pas été par des rabbins orthodoxes, conformément aux préceptes de l’orthodoxie. Les femmes présentes à la conférence de l’establishment ont été mobilisées en vue de manifester contre toute modification de la Loi du retour. La logique était la suivante : « C’est la droite qui fait ça. La droite, c’est le mal. Tout ce que la droite veut est mauvais pour les femmes. Par conséquent, nous, les féministes, devons nous opposer à cette modification de la Loi du retour. » Combattre la droite. Dans votre for intérieur, vous savez que le féminisme est un combat pour les femmes, mais ne le dites à personne d’autre : ni à Shamir, ni aux rabbins orthodoxes, ni à la presse ; et surtout pas aux jeunes juifs américains qui parrainent votre conférence, qui sont en Israël en ce moment pour faire pression sur Shamir et pour garder un œil sur les filles. Combattre la droite. Trouvez une question importante pour les hommes juifs et présentez-vous en tant que représentantes des femmes. Rendez-les fiers. Et surtout, évitez de les offenser ou de les contrarier en les obligeant à se tenir à vos côtés pour défendre les droits des femmes.
Lors de la conférence de l’establishment, la protestation contre la modification de la Loi du retour a été présentée comme un « premier pas » contre le pouvoir des rabbins orthodoxes. Étant donné que le pouvoir de ces hommes sur la vie des femmes juives en Israël est étendu et pernicieux, « faire un premier pas » contre eux — sans mentionner aucune des façons dont ils tyrannisent déjà les femmes — n’était pas seulement inapproprié, c’était honteux. Nous devions faire un vrai pas en avant. En Israël, les femmes juives sont fondamentalement — dans la réalité, dans la vie de tous les jours — gouvernées par la loi de l’Ancien Testament. Voilà pour l’égalité des sexes. Les rabbins orthodoxes prennent la plupart des décisions juridiques qui ont un impact direct sur le statut et la qualité de vie des femmes. Ils ont le dernier mot sur toutes les questions de « statut personnel », derrière lesquelles les féministes reconnaîtront la fameuse sphère privée dans laquelle les femmes, civilement subordonnées, sont traditionnellement emprisonnées. Les rabbins orthodoxes décident des questions de mariage, d’adultère, de divorce, de naissance, de mort, de légitimité, de ce qu’est le viol et de la légalité ou de l’illégalité de l’avortement, des coups et blessures et du viol dans le mariage. Lors de leur protestation, ces féministes n’ont même pas mentionné les femmes.
Comment Israël en est-il arrivé là ? Comment ces rabbins orthodoxes ont-ils obtenu le pouvoir dont ils disposent sur les femmes ? Comment les déloger, les éloigner des femmes ? Pourquoi les lois religieuses ne sont-elles pas supplantées par un ensemble de lois civiles garantissant aux femmes des droits réels et indiscutables à l’égalité et à l’autodétermination dans ce pays que nous avons tous et toutes contribué à construire ? J’ai 44 ans, Israël en a 42, comment diable cela a‑t-il pu se produire ? Qu’allons-nous faire maintenant ? Comment les féministes juives ont-elles réussi à ne pas « faire un premier pas » avant la fin de l’année 1988 et à ne pas mentionner les femmes ?
2. La condition des femmes juives en Israël est abjecte.
Là où je vis, les femmes sont loin d’avoir la vie belle. Compte tenu des statistiques de viols et de coups et blessures — piètre reflet de la réalité —, de l’inceste, de la pornographie, des meurtres en série, de la sauvagerie pure et simple de la violence à l’encontre des femmes, c’est un peu la Nuit de Cristal au quotidien. Mais en Israël, la situation est déchirante. Mes sœurs, nous avons construit un pays dans lequel les femmes sont de la merde de chien, quelque chose que l’on retire de sa chaussure en frottant. Nous, les « féministes juives ». Nous qui ne poussons pas plus loin que ne l’autorisent les hommes juifs ici. Quand il est sérieux, le féminisme combat la hiérarchie des sexes et le pouvoir masculin. Les hommes n’ont pas le droit de se tenir au-dessus de vous, seuls ou en groupe. Ne les aidez pas à construire un pays dans lequel le statut des femmes s’amenuise au fur et à mesure que celui des hommes — des hommes là-bas et des hommes ici — augmente. D’après ce que j’ai vu, entendu et appris, nous avons participé à construire un enfer pour les femmes, un charmant enfer juif. N’est-ce pas pareil partout ? Eh bien, « partout » n’est pas plus jeune que moi ; « partout » n’a pas été fondé sur la prémisse de l’égalité des sexes. Le statut inférieur des femmes en Israël n’est pas unique, mais nous en sommes les seules responsables. Je me suis sentie humiliée par la façon dont les femmes sont traitées en Israël. Je me suis souvenue du directeur de mon école hébraïque, survivant de l’Holocauste, qui m’avait dit que je devais être juive d’abord, américaine ensuite, puis citoyenne du monde, et être humain enfin, et qu’autrement, j’aurais le sang des Juifs sur les mains. J’ai longtemps gardé le silence sur Israël pour ne pas avoir le sang des Juifs sur les mains. Il s’avère que je suis une femme en premier, en second et en dernier lieu — c’est tout un — et que j’ai le sang de Juifs sur les mains — le sang des femmes juives d’Israël.
Les divorces et les violences
En Israël, il existe des tribunaux religieux distincts pour les chrétiens, les musulmans, les druzes et les juifs. Les femmes de chaque groupe sont soumises à l’autorité des plus anciens systèmes de misogynie religieuse.
En 1953, une loi a été votée qui place tous les Juifs sous la juridiction des tribunaux religieux pour tout ce qui concerne le « statut personnel ». Dans les tribunaux religieux, les femmes, tout comme les enfants, les déficients mentaux, les aliénés et les criminels condamnés, ne peuvent pas témoigner. Une femme ne peut pas être témoin ni, bien entendu, juge. Une femme ne peut pas signer un document. Cela pourrait faire obstacle à l’égalité.
Selon la loi juive, le mari est le maître ; la femme lui appartient, d’ailleurs elle est l’une de ses côtes ; son devoir est d’avoir des enfants — de préférence dans la douleur ; souvenez-vous de l’Ancien Testament. Vous avez lu le livre. Vous avez vu le film. Mais vous ne l’avez pas vécu. En Israël, les femmes juives le vivent.
Le mari possède le droit exclusif de prononcer le divorce ; il s’agit d’un droit imprescriptible. La femme n’a pas ce droit et n’a aucun recours. Elle doit vivre avec son mari adultère jusqu’à ce qu’il la jette dehors (après quoi ses perspectives ne sont pas reluisantes). Si elle commet l’adultère, il peut très simplement se débarrasser d’elle (après quoi ses perspectives sont pires). Elle doit vivre avec un agresseur jusqu’à ce qu’il en ait fini avec elle. En partant, elle se retrouverait sans abri, pauvre, stigmatisée, déplacée, paria, exilée intérieure en Terre promise. En partant sans l’autorisation officielle des tribunaux religieux, elle pourrait être considérée comme une « épouse rebelle », une catégorie juridique de femmes en Israël qui n’a, bien sûr, pas d’équivalent masculin. Une « épouse rebelle » perd la garde de ses enfants et tout droit à une aide financière. On estime à 10 000 le nombre d’agunot — « femmes enchaînées » — dont les maris refusent de divorcer. Certaines sont des prisonnières, d’autres des fugitives ; aucune ne possède les droits fondamentaux de la citoyenneté ou le statut de personne humaine.
Personne ne connaît l’ampleur des violences. D’après l’ouvrage Sisterhood Is Global, en 1978, environ 60 000 cas de femmes battues ont été signalés ; seuls deux hommes ont été incarcérés. En 1981, j’ai discuté avec Marcia Freedman, ancienne membre du Parlement israélien et fondatrice du premier refuge pour femmes battues en Israël — refuge où je me suis rendue à Haïfa. À l’époque, elle pensait que les violences conjugales en Israël étaient dix fois plus fréquentes que dans notre pays. De récentes auditions au Parlement ont conclu que 100 000 femmes sont battues chaque année dans leur propre maison.
Marcia Freedman était à Haïfa quand j’y étais. Je n’ai vu qu’une partie de ce qu’elle et d’autres féministes ont accompli en Israël et contre toute attente. Il y a maintenant cinq refuges en Israël. Le refuge de Haïfa est un grand bâtiment situé en ville. Il ressemble aux autres bâtiments. Les rues sont pleines d’hommes. La porte est fermée à clé. Une fois à l’intérieur, vous montez plusieurs volées de marches pour arriver à une grande porte en fer à l’intérieur du bâtiment, le genre de porte qu’on installe dans les prisons de haute sécurité pour hommes. Elle est verrouillée en permanence. Il s’agit de leur seule véritable défense contre les hommes violents. Et derrière la porte de fer, il y a les femmes et les enfants ; de grandes pièces communes, propres et nues ; de petites pièces immaculées dans lesquelles vivent les femmes et leurs enfants ; un bureau ; un salon ; les dessins des enfants qui vivent là — colorés, souvent violents — et, au dernier étage, une école, avec des enfants Palestiniens et israéliens, minuscules, jeunes, parfaits, beaux. Ce foyer est l’un des rares endroits en Israël où les enfants arabes et juifs sont éduqués ensemble. Leurs mères vivent ensemble. Derrière les lourds barreaux de fer, là où les femmes s’enferment volontairement afin de rester en vie, se trouve un modèle vivant de coopération palestino-israélienne : derrière les barreaux de fer qui empêchent les hommes violents — juifs et arabes — d’entrer. Les féministes ont réussi à obtenir des aides au logement pour les femmes qui ont la permission de vivre en dehors du domicile conjugal, mais le processus de qualification peut prendre jusqu’à un an. Les femmes qui gèrent le refuge essaient de reloger les femmes rapidement — en vue d’accueillir d’autres femmes — mais certaines femmes restent jusqu’à un an. Le soir, les femmes qui gèrent le refuge, qui sont désormais des professionnelles, rentrent chez elles, tandis que les femmes battues restent. La grande porte en fer est leur seule protection. Et si — et s’il venait ? Les femmes peuvent appeler la police ; la police viendra. Le policier qui fait la ronde est gentil. Il s’arrête parfois. Parfois, elles lui donnent une tasse de café. Mais dehors, il n’y a pas si longtemps, une femme a été battue à mort par le mari qu’elle fuyait. Les femmes à l’intérieur ne sont pas armées ; le refuge n’est pas armé ; ceci dans un pays où les hommes sont armés. Il n’existe pas de réseau de refuges. Les emplacements des refuges sont connus. Les femmes doivent sortir pour trouver du travail et un endroit où vivre. Manifestement, les femmes sont battues — et battues à mort — ici aussi. Mais le mari ne bénéficie pas d’une aide aussi active de la part de l’État — sans parler du Dieu des Juifs. Et lorsqu’une femme juive obtient le divorce, elle doit éviter d’être en présence de son mari au tribunal. C’est un motif pour être battue à mort.
Un projet de « loi fondamentale sur les droits humains » récemment proposé en Israël — un équivalent contemporain de notre déclaration des droits — exempte le mariage et le divorce de toute garantie en matière de droits humains.
La pornographie
Il faut le voir pour le croire, même si le voir pourrait ne pas suffire. Au fil des ans, des féministes en Israël m’ont transmis ce message à de multiples reprises — je l’avais vu, mais je n’y croyais pas vraiment. Contrairement aux États-Unis, la pornographie en Israël n’est pas une industrie. On la trouve dans des magazines grand public et dans la publicité. Elle traite principalement de l’Holocauste. Les femmes juives y sont sexualisées sous forme de victimes de l’Holocauste sur lesquelles les hommes juifs peuvent se masturber. Le croiriez-vous, même si vous le voyiez ?
Les femmes israéliennes parlent de « pornographie de l’Holocauste ». Parmi les thèmes qu’elle aborde, on retrouve le feu, le gaz, les trains, la maigreur, la mort.
Dans un magazine de mode, trois femmes en maillot de bain ont l’air de regarder et de s’éloigner de deux hommes à moto. Les motos, en métal noir, se profilent de manière menaçante au premier plan et se dirigent vers les femmes. Les femmes, fragiles et sans défense dans leur quasi-nudité, sont à l’arrière-plan. Ensuite, les femmes, désormais en sous-vêtements légers, sont montrées en train de fuir les hommes, accent mis sur les cuisses, seins bombés, hanches mises en valeur. Leurs visages évoquent la peur et la nervosité. Les hommes les attrapent physiquement. Puis les femmes, désormais vêtues de nouveaux maillots de bain, gisent au sol, apparemment mortes, des parties de leur corps sectionnées et éparpillées tandis que des trains leur foncent dessus. Et alors même que l’on voit un bras et une jambe coupés, que les trains s’approchent d’elles, les femmes sont disposées de telle façon que leurs hanches et l’entrée de leur zone vaginale sont mises en valeur.
Ailleurs, un homme verse de l’essence sur le visage d’une femme. Ici, elle pose à côté d’un luminaire qui ressemble à un pommeau de douche.
Et là, deux femmes, côtes apparentes, en petite tenue, se tiennent devant un mur de pierre qui évoque une prison, avec un extincteur d’un côté et un four béant et crachant des flammes de l’autre. Leurs postures corporelles reproduisent celles des détenu·es dévêtu∙es des camps de concentration que l’on voit dans les photographies documentaires.
Bien sûr, on y trouve aussi un sadisme exempt de référence à une ethnie spécifique ou aux traumatismes de l’histoire — car évidemment, les hommes juifs savent aussi se comporter comme les autres hommes. La couverture du magazine montre une femme nue étalée, les jambes ouvertes, avec une emphase visuelle sur ses gros seins. Des clous sont plantés dans ses seins. D’énormes pinces sont attachées à un mamelon. Elle est entourée de marteaux, de pinces et de scies. Son visage présente ce qui ressemble à une expression orgasmique. La femme est réelle. Les outils sont dessinés. En légende, on lit : « Sexe dans l’atelier. »
Toutes les violences visuelles décrites ci-dessus ont été publiées par le même magazine. Monitin est un mensuel de gauche destiné à l’intelligentsia et à la classe supérieure. Ses productions et ses valeurs esthétiques sont haut de gamme. Les écrivains et intellectuels les plus éminents d’Israël y publient des articles. Dans The Jewish Advocate, Judith Antonelli rapporte que Monitin « contient les images les plus sexuellement violentes. Les photos abondent de femmes gisant retournées comme si elles venaient d’être attaquées. »
Dans un magazine pour femmes qui n’est pas sans rappeler le Ladies’ Home Journal, on trouve la photo d’une femme attachée à une chaise avec une grosse corde. Sa chemise est déchirée au niveau de ses épaules et du haut de sa poitrine, mais ses bras sont attachés contre elle, de sorte que seule la partie charnue du haut des seins est exposée. Elle porte un pantalon — il est mouillé. Un homme habillé, debout à côté d’elle, lui jette de la bière au visage. Aux États-Unis, on trouve ce type de photographies de femmes dans les magazines de bondage.
Pour les puristes, il existe un magazine pornographique israélien. En première page du numéro que j’ai vu, on pouvait lire le titre suivant : « ORGIE À YAD VASHEM ». Yad Vashem, c’est le mémorial de Jérusalem dédié aux victimes de l’Holocauste. Sous le titre, il y avait une photo d’un homme sexuellement enchevêtré avec plusieurs femmes.
Que tout cela signifie-t-il — à part que si vous êtes une femme juive, ne courez pas vers Israël, fuyez-le ?
Je me suis rendue à l’Institut pour l’étude des médias et de la famille, rue Herzelia à Haïfa, une organisation créée pour lutter contre les violences infligées aux femmes. En collaboration avec le centre d’aide aux victimes de viols (et tout en s’efforçant continuellement et désespérément de collecter des fonds afin de subsister), l’institut analyse le contenu de la violence médiatique à l’encontre des femmes ; il dénonce et combat la légitimité que procure à la pornographie son incorporation dans les médias grand public.
Les femmes sont indignées par la pornographie de l’Holocauste — le choc est profond et permanent. Cependant, elles ne parviennent pas à comprendre. Moi non plus. Après en avoir vue des bribes ici, après avoir essayé de l’appréhender, puis après en avoir vu des piles à l’institut, je me suis sentie écrasée, bouleversée. Ici, j’avais des diapositives ; en Israël, j’ai vu les magazines entiers — le contexte dans lequel les photographies avaient été publiées. Des médias grand public diffusaient réellement une pornographie violente, avec une prépondérance de pornographie de l’Holocauste. C’était encore pire : plus réel, plus incompréhensible. Une semaine plus tard, j’ai parlé de pornographie à Tel Aviv devant un public essentiellement féministe. Une féministe a suggéré que je versais dans le deux poids, deux mesures : tous les hommes ne faisaient-ils pas cela, et non seulement les Israéliens ? J’ai répondu que non : aux États-Unis, les hommes juifs ne consomment pas de pornographie de l’Holocauste ; les hommes noirs ne consomment pas de pornographie des plantations. Mais maintenant, je n’en suis plus si sûre. Ne s’agit-il que d’une supposition ? Pourquoi les hommes israéliens aiment-ils cela ? Pourquoi le font-ils ? Et que les choses soient claires, ils en sont entièrement responsables ; on ne trouve même pas de femmes alibis dans les échelons supérieurs des médias, de la publicité ou de l’édition — pas plus que de nazis fugitifs avec de nouvelles identités. Je pense que les féministes en Israël devraient faire de ce pourquoi une question essentielle. Soit la réponse nous apprendra quelque chose de nouveau sur la sexualité des hommes partout dans le monde, soit elle nous apprendra quelque chose de particulier sur la sexualité des hommes qui passent du statut de victime à celui de bourreau. Comment l’Holocauste a‑t-il été sexualisé pour les hommes israéliens et quel rapport cela entretient-il avec la violence sexualisée à l’encontre des femmes en Israël ; quel rapport avec cette vaste dynamique qui dégrade continuellement le statut des femmes ? Les nazis vont-ils une nouvelle fois détruire les femmes juives, mais cette fois-ci par l’intérim des hommes israéliens ? La sexualité des hommes israéliens est-elle façonnée par l’Holocauste ? Cela les fait-il jouir ?
Je ne sais pas si les hommes israéliens sont différents des autres hommes pour la raison qu’ils utilisent l’Holocauste contre les femmes juives — à des fins d’excitation sexuelle. Je sais que l’utilisation de la pornographie de l’Holocauste est insupportablement traumatisante pour les femmes juives. Je sais que sa présence dans la sphère médiatique grand public israélienne constitue elle-même une forme de sadisme. Je sais également que tant que la pornographie de l’Holocauste existera, seuls les hommes juifs seront différents de ces pitoyables créatures dans les trains et dans les camps. Les femmes juives connaissent un sort similaire. En quoi, alors, Israël nous sauve-t-il ?
Et toutes les autres joyeusetés
Bien sûr, on retrouve en Israël toutes les autres délicatesses que les garçons font habituellement aux filles : le viol, l’inceste, la prostitution. Le harcèlement sexuel dans les lieux publics, dans la rue, est omniprésent, agressif et sexuellement explicite. Toutes les femmes avec lesquelles j’ai discuté et qui venaient d’ailleurs m’ont confié leur rage d’avoir été apostrophées dans la rue, sous des arrêts de bus, dans des taxis, par des hommes qui voulaient baiser et qui l’exprimaient ouvertement. Ces hommes étaient juifs et arabes. Dans le même temps, à Jérusalem, des hommes orthodoxes jettent des pierres aux femmes qui n’ont pas les bras couverts. Les garçons palestiniens qui lancent des pierres sur les soldats israéliens se font tirer dessus à balles réelles — en caoutchouc ou non. Les agissements des hommes orthodoxes qui lancent des pierres sur des femmes sont considérés comme insignifiants et non comme de véritables agressions. D’une certaine manière, c’est apparemment leur droit. Mais que n’ont-ils pas le droit de faire ?
À Tel Aviv, avant ma conférence, j’ai discuté avec un soldat israélien, âgé de 19 ans peut-être, qui fait partie de l’armée d’occupation en Cisjordanie. Il était chez lui pour le sabbat. Sa mère, une féministe, m’a généreusement ouvert sa maison. La mère et le fils étaient pratiquant·es ; le père était un libéral laïc. J’étais avec la meilleure amie de la mère, qui avait organisé la conférence. Les deux femmes étaient exceptionnellement gentilles, douces et généreuses. Avant ça, j’avais participé avec environ quatre cents femmes à une veillée à Jérusalem contre l’occupation. Pendant un an, des féministes de Haïfa, Jérusalem et Tel-Aviv avaient organisé chaque semaine une veillée appelée « Femmes en noir » — des femmes en deuil pour la durée de l’occupation. Le père et le fils étaient scandalisés par les manifestations. Le père a fait valoir que les manifestations n’avaient rien à voir avec le féminisme. Le fils que l’occupation n’avait rien à voir avec le féminisme.
J’ai interrogé le fils sur un fait qui m’avait été décrit : les soldats israéliens vont dans les villages Palestiniens et répandent des ordures, du verre brisé ou des pierres dans les rues et obligent les femmes à nettoyer ces dangereux déchets à mains nues, sans outils. Je pensais que le fils nierait ces faits ou qu’il dirait qu’il s’agissait d’une aberration. Au lieu de cela, il a soutenu que cela n’avait rien à voir avec le féminisme. Ainsi, il me révélait que ce type d’agression était courant ; il l’avait manifestement vu ou fait à maintes reprises. Sa mère s’est mise à baisser la tête. Elle ne l’a pas relevée avant la fin de la discussion. Je lui ai répondu que le rapport avec le féminisme, c’était qu’on infligeait ça à des femmes. Il a rétorqué que c’était uniquement parce que les hommes arabes étaient des lâches, qu’ils couraient et se cachaient. Les femmes, a‑t-il dit, étaient fortes ; elles n’avaient pas peur, elles restaient. Ce que cela avait à voir avec le féminisme, lui ai-je encore dit, c’est que la vie de chaque femme, pour une féministe, possède la même valeur. Le féminisme signifie que la vie d’une femme arabe vaut autant que celle de sa mère. Imaginons que des soldats débarquent ici maintenant, lui ai-je dit, et obligent ta mère à sortir dans la rue, à se mettre à genoux et à nettoyer des débris de verre à mains nues ?
J’ai ajouté que le féminisme avait aussi à voir avec lui, avec le type d’homme qu’il était ou qu’il devenait, avec ce que le fait de blesser d’autres personnes lui ferait — à quel point cela le rendrait-il sadique ou insensible ? Comprenant parfaitement, il m’a répondu : tu veux dire qu’il sera plus facile de violer ?
Il a dit que les Arabes méritaient d’être abattus, parce qu’ils jetaient des pierres sur les soldats israéliens ; je n’étais pas là, je ne savais pas, et quel était le rapport avec le féminisme de toute façon ? Je lui ai répondu que des hommes orthodoxes jetaient des pierres sur des femmes à Jérusalem parce que les bras des femmes n’étaient pas couverts jusqu’au poignet. Il a dit qu’il était ridicule de comparer les deux. Je lui ai dit que la seule différence, c’était que les femmes ne portaient pas de fusils et n’avaient pas le droit de tirer sur les hommes. Il a répondu que ce n’était pas la même chose. Je lui ai demandé de me dire quelle était la différence. Une pierre n’était-elle pas une pierre — pour une femme aussi ? N’étions-nous pas de la chair, ne saignions-nous pas, ne pouvions-nous pas être tuées par une pierre ? Les soldats israéliens sont-ils vraiment plus fragiles que des femmes aux bras nus ? D’accord, a‑t-il dit, vous avez le droit de leur tirer dessus, mais ensuite, vous devrez être jugés de la même manière que nous le sommes si nous tuons des Arabes. J’ai dit qu’ils n’avaient pas à être jugés. Sa mère a levé la tête pour dire qu’il y avait des règles, des règles strictes, pour les soldats, vraiment, et qu’elle n’avait pas honte de son fils. « Nous n’avons pas honte », a‑t-elle dit en implorant son mari, qui restait muet. « Nous n’avons pas honte de lui. »
Je me souviens de la chaleur du soleil de Jérusalem. Des centaines de femmes vêtues de noir étaient rassemblées sur les trottoirs d’une grande place publique de Jérusalem. Les « Femmes en noir » ont commencé à Jérusalem en même temps que l’Intifada, avec sept femmes qui ont organisé une veillée silencieuse pour exprimer leur opposition à l’occupation. Aujourd’hui, les centaines de femmes qui y participent chaque semaine dans trois villes différentes sont confrontées à des moqueries sexuelles et parfois à des jets de pierres. Étant donné que les manifestations sont réservées aux femmes, elles sont doublement conflictuelles : parce qu’il s’agit d’Israéliennes qui veulent la paix avec les Palestinien·nes ; parce que ce sont des femmes qui manifestent dans l’espace public. Les femmes tenaient des pancartes en hébreu, en arabe et en anglais qui disaient : « METTEZ FIN À L’OCCUPATION. » Un vendeur arabe a offert à certaines d’entre nous, à celles qu’il pouvait atteindre, des raisins et des figues pour nous aider à supporter la chaleur. Des Israéliens passaient en criant des insultes. Des hommes vociféraient des injures depuis leurs voitures. La circulation était dense. Les hommes essayaient de rentrer chez eux avant le soir de la veille du sabbat, lorsque Jérusalem ferme ses portes. Il y avait aussi des hommes avec des pancartes qui criaient que les femmes étaient des traîtresses et des putes.
Comme la plupart des manifestantes, je venais de la post-conférence organisée par des féministes laïques issues de la base. La post-conférence était présidée par Nabila Espanioli, une Palestinienne qui parlait hébreu, anglais et arabe. Des femmes palestiniennes sont sorties de l’auditoire pour témoigner à la première personne de ce que l’occupation leur fait subir. Elles ont surtout parlé de la brutalité des soldats israéliens. Elles ont parlé d’humiliations, de détentions forcées, d’intrusions, de menaces. Elles ont parlé d’elles-mêmes et des femmes. Pour les femmes palestiniennes, l’occupation est un État policier et la police secrète israélienne un danger permanent. Il n’y a pas d’« espace sûr » (safe space). Je savais déjà que j’avais du sang palestinien sur les mains. Ce que j’ai découvert en Israël, c’est qu’il n’est pas plus facile à laver que le sang juif — et qu’il est aussi féminin.
J’avais rencontré Nabila lors de ma première nuit en Israël, à Haïfa, chez une Israélienne qui avait organisé une merveilleuse fête de bienvenue. C’était une nuit chaude et parfumée. Le petit et bel appartement où circulait l’air nocturne était rempli de femmes de Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa — des féministes qui luttent pour les femmes, contre la violence. C’était la veille du sabbat. Nous avons participé à une simple cérémonie féministe — un partage du pain, un seul pain, toutes ensemble ; des paroles séculaires de paix et d’espoir. Après quoi je me suis retrouvée à parler avec une femme palestinienne qui étudiait la pornographie. C’était son domaine d’étude. Elle le connaissait sur le bout des doigts. Elle se reconnaissait en lui, écrasée par lui, violée par lui. Elle m’a dit qu’il s’agissait du point focal de sa résistance contre le viol et le racisme sexuel. Elle aussi voulait la liberté, mais la pornographie barrait la voie. Je me suis dit : avec ce que nous partageons, qui pourrait nous séparer ? Nous voyons les femmes avec les mêmes yeux.
En Israël, il y a deux sortes d’occupé·es : les Palestinien·nes et les femmes. Dans l’Israël que j’ai vu, les Palestinien·nes sont les plus susceptibles d’obtenir la liberté. Je n’ai retrouvé aucun de mes arbres.
Andrea Dworkin
1990
Traduction : Nicolas Casaux
L’article Israël : mais d’ailleurs, à qui est ce pays ? (par Andrea Dworkin) est apparu en premier sur Le Partage.